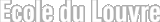Contrôle d'accès aux cours
La carte d’auditeur libre de l’École du Louvre est destinée au contrôle d’accès aux cours auxquels vous êtes inscrits et doit être présentée pour accéder aux espaces d’enseignement.
Auditeurs libres des cours à Paris et des cours en ligne
Durant sa période de validité, votre carte permet un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires :
- du musée du Louvre,
- du musée Eugène Delacroix,
- du musée d’Orsay,
- du musée de l’Orangerie.
Elle offre un tarif réduit :
- au musée national des arts asiatiques - Guimet,
- au musée Rodin,
- au musée national d’art moderne (Centre Pompidou).
Durant sa période de validité, la carte d'auditeur libre du cours d'initiation à l'histoire mondiale de l'architecture donne de plus un accès gratuit et illimité aux collections permanentes de la Cité de l'architecture et du patrimoine.
À noter : la carte d’auditeur libre de l’École du Louvre ne permet pas d’accès prioritaire "coupe-file".
Auditeurs libres des cours en régions
Votre carte est exclusivement destinée au contrôle d’accès aux cours. Contrairement à celle des auditeurs libres des cours à Paris et des cours en ligne, elle ne donne pas droit aux réductions ou gratuités dans les musées.
lms.ecoledulouvre.fr
Accédez à :
- Vos cours (ressources pédagogiques et bibliographies)
- Extranet (planning des cours, annulation et report, informations pratiques)
Cours de spécialité
EN PRÉSENTIEL UNIQUEMENT
Les enseignements de spécialité, issus de la recherche, couvrent un vaste champ de disciplines en archéologie, histoire de l’art et anthropologie. Soit une offre de trente-et-une disciplines pour autant de cours dispensés par des professionnels du patrimoine, conservateurs, universitaires et chercheurs.
Dates : d’octobre à avril.
Durée d'une séance : 1h00 à 2h00 selon les cours.
Les enseignements sont donnés en langue française.
En cas de nécessité, des modifications de calendrier et d'intervenants peuvent survenir. En cas de dégradation de la situation sanitaire ou sociale, la continuité pédagogique des cours sera assurée via le campus numérique de l'École du Louvre.
Pour s’inscrire au titre de la formation continue (prise en charge des frais d’inscription par votre employeur) écrire à : formation.continue[a]ecoledulouvre.fr.
Je m'inscris par voie postale
Des places sont disponibles par correspondance, veuillez trouver ci-dessous les documents à télécharger et à envoyer :
 Archéologie de l'Europe pré et proto-historique (n°4)
Archéologie de l'Europe pré et proto-historique (n°4)L’invention du guerrier à l’âge du Bronze en Europe occidentale : faits de guerre, armement et représentations symboliques. - Jour et horaire : vendredi (10 séances : 10h00 - 12h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
L’image du guerrier en armes de la Protohistoire est profondément ancrée dans l’imaginaire collectif, que ce soit à travers la littérature historique, la culture populaire ou encore les récits de l’heroic fantasy. Cette représentation, souvent simpliste, plonge ses racines dans deux grandes sources. Les textes littéraires anciens, d’une part, à l’exemple d’Hésiode, dès le VIIIe siècle av. J.-C., ont longtemps décrit les hommes de l’âge d’airain comme des «… hommes violents et terribles », qui « ne se plaisaient qu'aux injures et aux sanglants travaux de Mars…». L’archéologie et la muséographie, d’autre part, ont largement contribué à renforcer cette image du guerrier, notamment en raison de l’omniprésence des armes dans les corpus métalliques découverts depuis le XIXe siècle. Les dépôts, dragages et trouvailles fortuites ont révélé une quantité impressionnante d’armes, qui occupent également une place centrale dans l’iconographie rupestre et les stèles de l’époque. Parmi ces armes, l’épée tient un rôle particulier, souvent perçue comme un marqueur fort de l’identité guerrière. Elle symbolise une transition essentielle entre des pratiques de combat à distance, incarnées par l’archer, et des affrontements rapprochés où les combattants sont clairement identifiés.
Pour explorer la question des violences interpersonnelles à l’âge du Bronze en Europe occidentale, les objets d’étude sont les armes offensives et défensives : épées, arcs, boucliers, casques et cuirasses, les faits de guerre à travers les possibles champs de bataille identifiés, les vestiges humains et matériels retrouvés et les structures défensives. Une démarche pluridisciplinaire associe l’étude des vestiges archéologiques, l’analyse des sources iconographiques et littéraires ainsi que des comparaisons avec d’autres aires culturelles.
OctobreNovembreVendredi 7 novembre 2025, 10h00Estelle Gauthier,Maitre de conférences, Université de Franche Comté.Vendredi 14 novembre 2025, 10h00Cyril Marcigny,directeur-adjoint scientifique et technique de Normandie, Institut national de recherches archéologiques préventives.DécembreJanvierVendredi 16 janvier 2026, 10h00Les sites fortifiés dans le domaine nord-alpinEstelle Gauthier,Maitre de conférences, Université de Franche Comté.FévrierMarsVendredi 13 mars 2026, 10h00Rolande Simon-Millot,conservatrice générale du patrimoine , responsable des collections Néolithique et Âge du Bronze, musée d'Archéologie nationale et Domaine de Saint-Germain-en-Laye.Vendredi 20 mars 2026, 10h00Conclusion : l’image du guerrierRolande Simon-Millot,conservatrice générale du patrimoine , responsable des collections Néolithique et Âge du Bronze, musée d'Archéologie nationale et Domaine de Saint-Germain-en-Laye.- Estelle GauthierMaitre de conférences, Université de Franche Comté
- Cyril Marcignydirecteur-adjoint scientifique et technique de Normandie, Institut national de recherches archéologiques préventives
- Rolande Simon-Millotconservatrice générale du patrimoine , responsable des collections Néolithique et Âge du Bronze, musée d'Archéologie nationale et Domaine de Saint-Germain-en-Laye
 Archéologie de l'Europe pré et proto-historique▶ Inscriptions Closes
Archéologie de l'Europe pré et proto-historique▶ Inscriptions Closes Archéologie de la Gaule (n°5)
Archéologie de la Gaule (n°5)- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 10h45 - 12h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Dürer.
- Début du cours : vendredi 24 octobre 2025.
L’Antiquité tardive est marquée par les grandes migrations qui ébranlent le pouvoir impérial. Cette période d’instabilité est caractérisée par des déplacements et des regroupements de peuples venus de l’est et du nord de l’Europe. L’Empire romain, fragilisé par les incursions de ces turbulents voisins venus piller ses richesses, est contraint de défendre ses frontières avec une partie d’entre eux, qu’il a fédéré en échange de terres. La Gaule se transforme alors progressivement jusqu’à l’effondrement de l’administration romaine qui est remplacée par des royaumes barbares héréditaires, parmi lesquels finit par s’affirmer le pouvoir franc. Débute alors l’époque mérovingienne durant laquelle s’opère de profondes mutations, caractérisées par une ruralisation de la société et le triomphe du christianisme. C’est grâce à l’archéologie que la culture matérielle et les modes de vie des différents peuples qui occupent le barbaricum européen peuvent être appréhendés durant ces âges troubles. Elle permet également d’établir les relations qu’ils développent peu à peu avec l’empire romain jusqu’à provoquer sa chute en occident. Les avancées de la recherche, enrichies des nombreuses fouilles issues du développement de l’archéologie préventive, permettent d’analyser l’évolution que subit la Gaule entre Ve le VIIIe siècle suite à l’installation de ces peuples dits « germaniques ». Différents types d’habitats peuvent ainsi être distingués, ainsi que les activités artisanales et commerciales qui s’y concentrent. L’archéologie funéraire s’est quant à elle enrichie de nouvelles approches qui appréhendent plus précisément les considérations de la société mérovingienne face à la mort. Le mobilier qui en est issu permet de constater l’excellence des artisans mérovingiens, particulièrement dans les arts du métal. Le christianisme s’implante quant à lui définitivement en Gaule avec la création d’églises et de monastères, où il influence un art complexe, au croisement d’un héritage gallo-romain et de cultures barbares.
OctobreVendredi 24 octobre 2025, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.Vendredi 21 novembre 2025, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.JanvierVendredi 16 janvier 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.FévrierVendredi 13 février 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.MarsVendredi 13 mars 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.Vendredi 20 mars 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.Vendredi 27 mars 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.AvrilVendredi 3 avril 2026, 10h45Franck Abert,Conservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon.- Franck AbertConservateur du patrimoine, Musée archéologique de Dijon
 Archéologie de la Gaule▶ Inscriptions Closes
Archéologie de la Gaule▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art et archéologie de l'Égypte (n°6)Les hybrides de l’Égypte : iconographies, significations et transferts culturels.
Histoire de l'art et archéologie de l'Égypte (n°6)Les hybrides de l’Égypte : iconographies, significations et transferts culturels.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 13h30 - 15h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Dès le début du troisième millénaire avant J.-C., des divinités égyptiennes sont représentées sous la forme d’hybrides. Cette hybridité connaît diverses configurations : humains à têtes animales, animaux à têtes humaines, créatures composites additionnant plusieurs éléments du vivant. Il est possible de dresser un panorama des inventions manifestées dans le monde pharaonique, en montrant les liens étroits entre des iconographies et des interprétations qu’elles attestent. L’étude de ces hybrides permet de saisir la particularité du mode de pensée et de représentation des anciens Égyptiens – et de comprendre, par contraste, le changement fondamental de signification qui accompagne l’évolution de leurs formes, lorsque d’autres cultures du monde méditerranéen s’approprient ces hybrides.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 13h30Gabrielle Charrak,Vendredi 31 octobre 2025, 13h30Gabrielle Charrak,NovembreVendredi 14 novembre 2025, 13h30Gabrielle Charrak,Vendredi 28 novembre 2025, 13h30Gabrielle Charrak,DécembreVendredi 12 décembre 2025, 13h30Gabrielle Charrak,JanvierVendredi 9 janvier 2026, 13h30Gabrielle Charrak,Vendredi 23 janvier 2026, 13h30Gabrielle Charrak,FévrierVendredi 6 février 2026, 13h30Gabrielle Charrak,Vendredi 20 février 2026, 13h30Gabrielle Charrak,MarsVendredi 6 mars 2026, 13h30Gabrielle Charrak,- Gabrielle Charrak
 Histoire de l'art et archéologie de l'Égypte▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art et archéologie de l'Égypte▶ Inscriptions Closes Archéologie orientale (n°7)premier semestre
Archéologie orientale (n°7)premier semestre
L’Arabie orientale à l’âge du Bronze. second semestre
Kanesh et l’Anatolie à l’aube du IIe millénaire avant notre ère.- Jours et horaires : mardi (14 séances : 13h00 - 14h00, 4 séances : 13h00 - 14h30).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne, École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : mardi 14 octobre 2025.
premier semestre
L’Arabie orientale à l’âge du Bronze.
Marianne Cotty,
conservatrice du patrimoine, département des Antiquités orientales, musée du Louvre
L’archéologie de l’Arabie orientale constitue une discipline relativement récente, dont le développement ne remonte qu’à une cinquantaine d’années. Longtemps perçue comme une périphérie éloignée du Proche-Orient ancien, cette région n’a que tardivement suscité l’intérêt des chercheurs. Pourtant, les rives du Golfe Arabo-Persique ont abrité, au cours du IIIe et du IIe millénaire avant notre ère, des cultures originales, notamment celles de Magan et de Dilmun, qui correspondent à l’Arabie orientale s’étendant du Koweït jusqu’au sud-est de la péninsule Arabique. Mentionnées dès le IIIe millénaire dans les textes cunéiformes mésopotamiens, Magan et Dilmun apparaissent comme des fournisseurs de matériaux précieux — tels que la diorite, le cuivre ou encore des essences de bois rares — indispensables aux cités-États mésopotamiennes. La maîtrise des échanges maritimes à longue distance permit aux marchands de ces régions d’acheminer ces ressources jusqu’aux ports mésopotamiens. Toutefois, Magan et Dilmun ne sauraient être réduites au rôle de simples plateformes commerciales : ces cultures témoignent d’un dynamisme propre, perceptible dans leurs pratiques funéraires, leurs innovations en matière d’économie de production, ainsi que dans l’organisation de leur territoire. Ces cultures, bien que distinctes, offrent un contrepoint intéressant aux modèles étatiques mésopotamien, harappéen ou nilotique, et méritent d’être reconnues pour leur originalité et leur complexité.
second semestre
Kanesh et l’Anatolie à l’aube du IIe millénaire avant notre ère.
Vincent Blanchard,
conservateur du patrimoine, département des Antiquités orientales, musée du Louvre
Le site archéologique de Kültepe, situé en Cappadoce au centre de la Turquie, correspond à la ville antique de Nesa/Kanesh. Cette cité était au cœur des échanges internationaux au début du IIe millénaire avant notre ère entre l’Anatolie, la Mésopotamie et la Syrie. L’activité commerciale intense de cette ville fut accompagnée de riches mélanges culturels qui sont à l’origine de l’art et de la culture du royaume hittite qui naît à peine cinquante ans après l’abandon de Nesa. La découverte du site et de son histoire, celle du réseau commercial dont Nesa/Kanesh était le pôle majeur, permettent d’apprécier ses productions artistiques originales, notamment les nombreux sceaux-cylindres de styles assyrien, syrien et anatolien à l’iconographie riche et variée. Nesa fut en outre l’un des plus grands centres de production de céramique du Proche-Orient ancien. Cette étude peut s’élargir à celle des éléments historiques, culturels et artistiques qui constituent les racines du royaume hittite. Nous complèterons enfin l’étude de ce site par d’autres site anatoliens majeurs qui faisaient partie du même grand réseau d’échanges comme Acem Höyük ou Beycesultan.
OctobreMardi 14 octobre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 21 octobre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 28 octobre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.NovembreMardi 25 novembre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.DécembreMardi 2 décembre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 9 décembre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 16 décembre 2025, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.JanvierMardi 6 janvier 2026, 13h00Marianne Cotty,conservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 13 janvier 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 20 janvier 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 27 janvier 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.FévrierMardi 3 février 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 10 février 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 17 février 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.MarsMardi 3 mars 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 10 mars 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 17 mars 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.Mardi 24 mars 2026, 13h00Vincent Blanchard,conservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre.- Vincent Blanchardconservateur du patrimoine, adjoint à la directrice du département, département des antiquités orientales, musée du Louvre
- Marianne Cottyconservatrice du patrimoine, département des antiquités orientales, musée du Louvre
 Archéologie orientale▶ Inscriptions Closes
Archéologie orientale▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art et archéologie du monde grec (n°8)
Histoire de l'art et archéologie du monde grec (n°8)- Jour et horaire : mercredi (10 séances : 14h30 - 16h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : mercredi 22 octobre 2025.
premier semestre
Les offrandes de l’époque archaïque dans les sanctuaires de Samos et de Milet.
Ludovic Laugier,
conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre
La période archaïque, au VIe siècle avant J.-C., représente la jeunesse de l’art grec, son radieux printemps. En effet, les statues de jeunes femmes et de jeunes hommes dédiés dans les sanctuaires ou marquant quelques riches tombes, des korès et des kouroï, arborent souvent un large sourire. C’est que, tout en répondant aux codes assez stricts de l’art archaïque, ce sont des œuvres de joie, faites pour ravir les dieux : des agalmata. Si Athènes brille par la série exceptionnelle des korès de l’Acropole, de l’autre côté de la mer Egée, en Grèce de l’Est, les sanctuaires d’Apollon à Didymes, près de Milet, où se tenait un fameux oracle, et celui de Samos, où Héra aurait vu le jour, ne paraissent pas en reste. Les élites ioniennes y ont consacré nombre d’offrandes créées dans un style typique de cette région, dont on peut étudier toutes les spécificités, jusqu’à déterminer si des styles locaux plus particuliers peuvent être discernés entre Samos, Milet, voire leurs opulentes voisines, Ephèse et Smyrne.
second semestre
L’univers des images dans la céramique grecque aux époques géométrique et archaïque (vers 750-480 av. J.-C.) : créations, mise en forme et mise en série.
Anne Coulié,
conservatrice en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre
D’une richesse exceptionnelle, les images peintes sur les vases témoignent, plus que dans tout autre civilisation antique, du goût particulier des Grecs pour les histoires et la figuration. On peut y découvrir l’univers foisonnant des images, génériques et mythologiques, tout en explorant les grands fondamentaux de l’étude de la céramique : la place des techniques picturales dans l’invention et l’évolution des images ; l’importance du volume des vases, supports de la représentation, dans la mise en forme des images ; et enfin l’outil de la mise en série, au fondement d’une démarche méthodique rigoureuse et actuelle. Ainsi peut-on dégager plusieurs thèmes : la renaissance des images à l’époque géométrique et archaïque, les images des dieux et les combinaisons panthéoniques, quelques cycles héroïques et le thème de la guerre, entre mythe et réalité.
OctobreMercredi 22 octobre 2025, 14h30Ludovic Laugier,conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.NovembreMercredi 5 novembre 2025, 14h30Ludovic Laugier,conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.Mercredi 26 novembre 2025, 14h30Ludovic Laugier,conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 14h30Ludovic Laugier,conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.Mercredi 17 décembre 2025, 14h30Ludovic Laugier,conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.JanvierMercredi 14 janvier 2026, 14h30Anne Coulié,conservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.Mercredi 28 janvier 2026, 14h30Anne Coulié,conservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.FévrierMercredi 11 février 2026, 14h30Anne Coulié,conservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.MarsMercredi 4 mars 2026, 14h30Anne Coulié,conservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.Mercredi 18 mars 2026, 14h30Anne Coulié,conservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.- Anne Couliéconservatrice en chef, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre
- Ludovic Laugierconservateur en chef du patrimoine, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre
 Histoire de l'art et archéologie du monde grec▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art et archéologie du monde grec▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art et archéologie du monde étrusque et italique (n°9)De Bologne à Mantoue : les Etrusques de la plaine du Pô (VIIIe-VIe siècles av. J.-C.).
Histoire de l'art et archéologie du monde étrusque et italique (n°9)De Bologne à Mantoue : les Etrusques de la plaine du Pô (VIIIe-VIe siècles av. J.-C.).- Jours et horaires : vendredi (3 séances : 12h45 - 14h15, 14 séances : 13h00 - 14h00, 1 séance : 13h00 - 14h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Dès les débuts de la civilisation étrusque, à l’époque dite villanovienne, Felsina (Bologne) apparaît comme un centre majeur, qui va contribuer au rayonnement des Étrusques dans la plaine du Pô. Une culture matérielle particulière se révèle à Bologne entre l’époque villanovienne et l’époque archaïque, connue notamment à travers de riches contextes funéraires, marqués par des stèles portant d’importants décors figurés. Il existe aussi d’autres centres de cette Étrurie padane, comme la ville nouvelle fondée à Marzabotto, les débuts de la cité de Mantoue et l’établissement portuaire de Spina dans les échanges avec le monde grec.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 24 octobre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 31 octobre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 14 novembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 21 novembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 28 novembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 12 décembre 2025, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 16 janvier 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 23 janvier 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.FévrierVendredi 13 février 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 20 février 2026, 12h45Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.MarsVendredi 6 mars 2026, 12h45Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 13 mars 2026, 12h45Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 20 mars 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.Vendredi 27 mars 2026, 13h00Laurent Haumesser,conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines.- Laurent Haumesserconservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines
 Histoire de l'art et archéologie du monde étrusque et italique▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art et archéologie du monde étrusque et italique▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art et archéologie du monde romain (n°10)Du forum au jardin : mettre en scène le pouvoir dans la Rome républicaine.
Histoire de l'art et archéologie du monde romain (n°10)Du forum au jardin : mettre en scène le pouvoir dans la Rome républicaine.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 13h30 - 15h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : vendredi 24 octobre 2025.
Du forum au jardin : mettre en scène le pouvoir dans la Rome républicaine.
premier semestre
De grands programmes architecturaux et décoratifs se déploient à Rome et dans le Latium à la fin de la République (IIe-Ier siècle av. J.-C.). L’analyse monuments emblématiques (sanctuaires, forum romain, édifices de spectacles), permet de repérer et de comprendre les mutations de l’urbanisme et de l’architecture dans un contexte de bouleversements politiques. L’accent est mis sur les commanditaires, les techniques, les innovations stylistiques et les enjeux idéologiques. À travers des figures comme Pompée ou César, on étudie comment l’élite investit l’espace pour affirmer prestige et légitimité. Le cours mobilise sources matérielles, iconographiques et littéraires, et les apports récents de la recherche.
second semestre
Une approche pluridisciplinaire permet d’étudier de manière fructueuse les jardins à la période républicaine et au début de l’ère impériale. On peut prendre appui sur des informations d’autant plus fécondes que ce thème bénéficie d’un intérêt renouvelé de la recherche archéologique. On y croise des données topographiques, des éléments d’architecture, des sculptures, des peintures et des objets, formant un corpus varié d’œuvres parfois prestigieuses, parfois confidentielles. Grâce aux textes antiques et aux études des archéologues et des historiens de l’art, la Maison aux Oiseaux décrite par Varron dans De Re Rustica prendra peut-être ainsi silhouette !
OctobreVendredi 24 octobre 2025, 13h30Sarah Busschaert,Conservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 13h30Sarah Busschaert,Conservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.Vendredi 21 novembre 2025, 13h30Sarah Busschaert,Conservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 13h30Sarah Busschaert,Conservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.Vendredi 19 décembre 2025, 13h30Sarah Busschaert,Conservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.JanvierVendredi 16 janvier 2026, 13h30Isabelle Bardiès-Fronty,conservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny.Vendredi 30 janvier 2026, 13h30Isabelle Bardiès-Fronty,conservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny.MarsVendredi 13 mars 2026, 13h30Isabelle Bardiès-Fronty,conservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny.Vendredi 27 mars 2026, 13h30Isabelle Bardiès-Fronty,conservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny.AvrilVendredi 3 avril 2026, 13h30Isabelle Bardiès-Fronty,conservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny.- Isabelle Bardiès-Frontyconservatrice générale du patrimoine, musée national du Moyen Âge, musée de Cluny
- Sarah BusschaertConservatrice du patrimoine- Responsable scientifique, Musée Départemental de la Céramique à Lezoux
 Histoire de l'art et archéologie du monde romain▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art et archéologie du monde romain▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art et archéologie de Byzance et des chrétientés en Orient (n°11)Baouît
Histoire de l'art et archéologie de Byzance et des chrétientés en Orient (n°11)Baouît
Splendeur des sables : le monastère égyptien de Baouît (Ve-IXe siècles)- Jour et horaire : lundi (20 séances : 12h30 - 13h30).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne, École du Louvre, Paris : Amphithéâtre DürerÉcole du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.
Fondé vers 390, Baouît fut pendant plusieurs siècles le plus grand monastère de Moyenne-Égypte, attirant des milliers de moines et réunissant de nombreux corps de métiers. Sa renommée a facilité la venue d'architectes, de peintres et de sculpteurs qui ont mis au point des programmes décoratifs où se mêlent des influences de Constantinople, d’Alexandrie et de Syrie, mais qui ont aussi fait naître des formes artistiques propres. Baouît a ainsi joué un rôle fondamental dans le développement d'un art chrétien en Égypte. Découvert par Jean Clédat en 1900, le site a été fouillé pendant plusieurs campagnes jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis 2003, les fouilles françaises ont repris grâce à un partenariat entre l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO) et le musée du Louvre, qui dirige le chantier depuis trois ans. Les travaux anciens et contemporains nous permettent de montrer les richesses de ce monastère, haut-lieu spirituel et artistique de l'Égypte byzantine.
OctobreLundi 13 octobre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientFlorence Calament,conservatrice en chef du patrimoine, département des antiquités égyptiennes, musée du Louvre.Lundi 20 octobre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 27 octobre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.NovembreLundi 3 novembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 10 novembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 17 novembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 24 novembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.DécembreLundi 1 décembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 8 décembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 15 décembre 2025, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.JanvierLundi 19 janvier 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 26 janvier 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.FévrierLundi 2 février 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 9 février 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 16 février 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.MarsLundi 2 mars 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 9 mars 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 16 mars 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 23 mars 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.Lundi 30 mars 2026, 12h30Histoire de l’art et archéologie de Byzance et des chrétientés en OrientCédric Meurice,ingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre.- Florence Calamentconservatrice en chef du patrimoine, département des antiquités égyptiennes, musée du Louvre
- Cédric Meuriceingénieur d'études, département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, Musée du Louvre
 Histoire de l'art et archéologie de Byzance et des chrétientés en Orient▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art et archéologie de Byzance et des chrétientés en Orient▶ Inscriptions Closes Arts et archéologie du judaïsme (avec le soutien de la Fondation Etrillard) (n°3)Un art sans territoire ? Synagogues, une architecture de l’identité juive.
Arts et archéologie du judaïsme (avec le soutien de la Fondation Etrillard) (n°3)Un art sans territoire ? Synagogues, une architecture de l’identité juive.- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 15h45 - 17h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : jeudi 16 octobre 2025.
Après une introduction sur la spécificité d’une civilisation qui s’est développée le plus souvent hors de son territoire initial d’implantation, la synagogue, édifice clé de la survie d’un peuple en diaspora et symbole de son statut, permet d’aborder l’histoire d’une architecture qui est à la fois reflet et instrument de construction de l’identité juive à travers le temps. En l’absence d’une architecture juive codifiée, la synagogue est donc le produit d’un dialogue avec les cultures dites « d’accueil », d’où son extrême diversité formelle, au gré des époques et des aires géographiques, mais aussi sa plasticité fonctionnelle qui l’a rendue capable de traverser toutes les situations. Sont aussi envisagées tant les sources bibliques que les références, historiques ou imaginaires, utilisées par les architectes, mais aussi la place, encadrée par des interdits, qu’y tiennent les arts.
OctobreJeudi 16 octobre 2025, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.Jeudi 30 octobre 2025, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.NovembreJeudi 13 novembre 2025, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.Jeudi 27 novembre 2025, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.DécembreJeudi 11 décembre 2025, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.JanvierJeudi 8 janvier 2026, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.Jeudi 22 janvier 2026, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.FévrierJeudi 5 février 2026, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.Jeudi 19 février 2026, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.MarsJeudi 5 mars 2026, 15h45Dominique Jarrassé,professeur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3.- Dominique Jarrasséprofesseur émérite d'histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux 3
 Arts et archéologie du judaïsme (avec le soutien de la Fondation Etrillard)▶ Inscriptions Closes
Arts et archéologie du judaïsme (avec le soutien de la Fondation Etrillard)▶ Inscriptions Closes Patrimoine et archéologie militaires (n°12)premier semestre
Patrimoine et archéologie militaires (n°12)premier semestre
L’Art de la Bataille.
second semestre
La musique militaire : entre ordonnance et apparat.- Jour et horaire : lundi (10 séances : 13h15 - 15h15).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Imhotep.
- Début du cours : lundi 20 octobre 2025.
premier semestre
L’Art de la Bataille.
La représentation de la bataille a toujours représenté un défi pour les artistes car l’action militaire requiert un agencement formel capable de transmettre l’ampleur des événements. Différents médiums mettent en image la bataille, du XIVe siècle au XVIIe siècle en Italie, France, Angleterre et Allemagne. Etudier son iconographie, dans les peintures comme les tapisseries, peut amener à privilégier quelques thèmes : la mise en scène de la tactique et du commandement, les armes et les armures, en réservant une place à celles qui ont un caractère votif après la victoire (ex voto de la cathédrale de Chartres) ; enfin, les scènes d’intervention des saints protecteurs militaires.
second semestre
La musique militaire : entre ordonnance et apparat.
La musique militaire joue un rôle fondamental dont témoignent non seulement des pratiques, des répertoires, mais des codes visuels spécifiques (notamment uniformologiques) et des représentations. On doit ainsi distinguer musique d’ordonnance et musique militaire, et, dans le cadre de la constitution officielle des régiments (ordonnance royale de 1754) ; mettre en évidence le rôle et les éléments distinctifs de ces unités, avec le personnage bien particulier du tambour-major (uniformes parmi les plus beaux de l’Ancien Régime et de l’Empire, sabres de Manceaux, cannes à pommeau d’argent…), les flammes de trompette, les instruments et leurs facteurs. Le XIXe siècle connaît aussi des écoles et réformes instrumentales spécifiques (conservatoire, gymnase musical etc.).
OctobreLundi 20 octobre 2025, 13h15Karen Watts,conservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni).NovembreLundi 3 novembre 2025, 13h15Karen Watts,conservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni).Lundi 17 novembre 2025, 13h15Karen Watts,conservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni).DécembreLundi 1 décembre 2025, 13h15Karen Watts,conservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni).Lundi 15 décembre 2025, 13h15Karen Watts,conservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni).JanvierLundi 12 janvier 2026, 13h15Guillaume Lecoester,conservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée.Lundi 26 janvier 2026, 13h15Guillaume Lecoester,conservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée.FévrierLundi 9 février 2026, 13h15Guillaume Lecoester,conservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée.MarsLundi 2 mars 2026, 13h15Guillaume Lecoester,conservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée.Lundi 16 mars 2026, 13h15Guillaume Lecoester,conservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée.- Guillaume Lecoesterconservateur du Patrimoine, chef du Département du dix-neuvième siècle et de la symbolique militaire, Musée de l’Armée
- Karen Wattsconservatrice émérite, Royal Armouries, Leeds (Royaume-Uni)
 Patrimoine et archéologie militaires▶ Inscriptions Closes
Patrimoine et archéologie militaires▶ Inscriptions Closes Histoire des arts de l'Extrême-Orient (n°13)Pouvoirs, rituels et images : la Corée ancienne au carrefour des cultures d’Asie (Ier s. av. J.-C. – Xe siècle apr. J.-C.).
Histoire des arts de l'Extrême-Orient (n°13)Pouvoirs, rituels et images : la Corée ancienne au carrefour des cultures d’Asie (Ier s. av. J.-C. – Xe siècle apr. J.-C.).- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 16h00 - 18h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
L’histoire doit-elle être enseignée comme un « récit national » ? En Corée, le Samguk sagi « Histoire Trois Royaumes » compilé en 1145 par Kim Busik, au cours de la dynastie des Goryeo, retrace la formation des premiers Etats indépendants de la péninsule : Silla, Baekje, Gaya (au sud), et Goguryeo (au nord), entre le premier siècle avant notre ère jusqu’à la fin du premier millénaire de notre ère. La Corée telle que nous la connaissons encore à ce jour, hérite directement de la formation de ces institutions politiques et des pratiques culturelles qui y ont émergé. Pourtant, il s'est avéré difficile de reconstruire un modèle cohérent de développement social et artistique de ces états sur la seule base de ce récit national, lui-même hérité de sources historiques régionales, mais aussi chinoises. Depuis la fin du XIXe siècle, les missions archéologiques conduites tant en Corée qu’en Chine du nord-est, contribuent à une relecture de la formation de ces États. Quoique partageant des cultures communes (shamanisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme), l’omniprésence de l’or et l’art équestre, elles se sont formées au contact de nombreuses autres civilisations (du Japon à l’est, de la steppe au nord, et jusqu’à l’Asie centrale et le monde Indien à l’Ouest). Situés au carrefour de dynamiques culturelles, politiques, économiques et sociales de l’Extrême-Asie, ces états connaissent de nombreuses transformations dans les pratiques rituelles, l’organisation des sociétés, et les coutumes artistiques qui en découlent.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 16h00Arnaud Bertrand,Chercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale..Vendredi 31 octobre 2025, 16h00Okyang Chae-Duporge,NovembreVendredi 14 novembre 2025, 16h00Okyang Chae-Duporge,Vendredi 28 novembre 2025, 16h00Okyang Chae-Duporge,DécembreVendredi 12 décembre 2025, 16h00Okyang Chae-Duporge,JanvierVendredi 9 janvier 2026, 16h00Okyang Chae-Duporge,Vendredi 23 janvier 2026, 16h00Arnaud Bertrand,Chercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale..MarsVendredi 6 mars 2026, 16h00Arnaud Bertrand,Chercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale..Vendredi 27 mars 2026, 16h00Arnaud Bertrand,Chercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale..AvrilVendredi 3 avril 2026, 16h00Arnaud Bertrand,Chercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale..- Arnaud BertrandChercheur associé, Chargé d’enseignement en Histoire de l’Art et Archéologie Chinoise , UMR 7041 « ArScAn », Archéologie de l’Asie centrale.
- Okyang Chae-Duporge
 Histoire des arts de l'Extrême-Orient▶ Inscriptions Closes
Histoire des arts de l'Extrême-Orient▶ Inscriptions Closes Art et archéologie de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie (n°14)Dieux et déesses du véhicule de Diamant, iconographie et style dans les peintures du bouddhisme tibétain
Art et archéologie de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie (n°14)Dieux et déesses du véhicule de Diamant, iconographie et style dans les peintures du bouddhisme tibétain- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 13h30 - 15h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne.
- Début du cours : jeudi 16 octobre 2025.
Dans l’ensemble de la sphère culturelle tibétaine, un art pictural de prime abord complexe et déconcertant incarne les concepts symboliques les plus élevés de la spiritualité du bouddhisme dit du « véhicule de Diamant » (sanskrit vajrayana¿; tibétain dorje thegpa). Au pays des Neiges, ainsi que les Tibétains eux-mêmes désignent leur pays, les principes salvifiques d’accès à l’Éveil sont explicités par des textes ou transmis oralement de maître à disciple ; ils peuvent également être représentés en images contrastées, aussi spectaculaires que complexes. Usuellement désignées par le terme tibétain de thangka – dont la caractéristique essentielle réside dans le fait que ce sont des œuvres mobiles et aisément transportables, que l’on peut enrouler et dérouler, accrocher ou décrocher à loisir –, les peintures sur support textile du monde tibéto-himalayen déclinent un répertoire presque infini de formes, élaborées selon des normes et des règles iconographiques rigoureuses par des artistes dont trop peu de noms nous sont parvenus. Ces derniers, moines ou laïcs, œuvraient dans un esprit respectueux des traditions des grandes lignées spirituelles dans la filiation desquelles telle ou telle image était réalisée. Parmi les divinités de méditation (sanskrit ishta devata ; tibétain yi dam) et les déités gardiennes de la doctrine (sanskrit dharmapala ; tibétain chos skyong), qui sont très souvent représentées sous des formes courroucées, dotées de têtes et de bras multiples, se repèrent quelques figures saillantes, parmi lesquelles les dieux tutélaires Chakrasamvara, Hevajra ou Kalachakra, ou encore les protecteurs de la religion, tels les dieux Mahakala et Mahavajrabhairava ou la déesse Palden Lhamo. Par ailleurs, on ne saurait négliger les mandala (tibétain kyil khor), ces « domaines » divins, organisés en cercles et carrés concentriques, appelant un cheminement visuel de la périphérie vers le centre en vue d’accéder à l’Éveil.
OctobreJeudi 16 octobre 2025, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.Jeudi 30 octobre 2025, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.NovembreJeudi 13 novembre 2025, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.Jeudi 27 novembre 2025, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.DécembreJeudi 18 décembre 2025, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.JanvierJeudi 15 janvier 2026, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.Jeudi 22 janvier 2026, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.FévrierJeudi 5 février 2026, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.Jeudi 19 février 2026, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.MarsJeudi 5 mars 2026, 13h30Thierry Zéphir,ingénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet.- Thierry Zéphiringénieur d'études, chargé de collections, section Népal-Tibet, musée national des arts asiatiques - Guimet
 Art et archéologie de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie▶ Inscriptions Closes
Art et archéologie de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie▶ Inscriptions Closes Histoire des arts de l'Islam (n°15)Des arts et des lettres : le Shahnameh « Livre des rois » de Ferdowsi.
Histoire des arts de l'Islam (n°15)Des arts et des lettres : le Shahnameh « Livre des rois » de Ferdowsi.- Jour et horaire : lundi (10 séances : 15h45 - 17h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne.
- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.
Le Shahnameh, monument littéraire de l’Iran, a été mis en vers l’an 1000 par le poète Ferdowsi. Puisant dans des sources diverses, l’épopée raconte l’histoire des rois d’Iran, depuis le premier souverain mythique, jusqu’à la chute de l’empire sassanide en 651. Si le plus ancien manuscrit à nous être parvenu date de 1217, il nous reste d’innombrables manuscrits illustrés depuis le début du XIVe siècle dont des chefs d’œuvre de la peinture. Les représentations des épisodes tirés de l’épopée ont également intégré le registre des objets d’art et du décor architectural. Aujourd’hui encore, plus de mille ans après sa composition, le livre continue à être lu par des millions de persanophones et suscite la recherche scientifique et l’inspiration pour les artistes contemporains.
Le cours ambitionne de faire une synthèse la plus exhaustive possible sur ce monument de la littéraire persane.
Seront abordés les aspects littéraires, mythologiques, historiques et historiographiques, puis l’histoire de l’art concernant le Shahnameh : des témoignages peints de l’Asie centrale au VIIIe siècle aux manuscrits illustrés, ainsi que l’iconographie dérivée du Shahnameh sur les productions artistiques hors livres jusqu’à la période contemporaine, sans oublier les arts performatifs.
OctobreLundi 13 octobre 2025, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.Lundi 27 octobre 2025, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.NovembreLundi 10 novembre 2025, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.Lundi 24 novembre 2025, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.DécembreLundi 8 décembre 2025, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.JanvierLundi 5 janvier 2026, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.Lundi 19 janvier 2026, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.FévrierLundi 9 février 2026, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.Lundi 16 février 2026, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.MarsLundi 2 mars 2026, 15h45Farhad Kazemi,conservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre.- Farhad Kazemiconservateur du patrimoine, chargé des collections de l’Iran médiéval, musée du Louvre
 Histoire des arts de l'Islam▶ Inscriptions Closes
Histoire des arts de l'Islam▶ Inscriptions Closes Histoire des arts d'Afrique (n°16)Appréhender les arts africains à l’aune des « logiques métisses ».
Histoire des arts d'Afrique (n°16)Appréhender les arts africains à l’aune des « logiques métisses ».- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 10h45 - 12h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Dürer.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
premier semestre
Appréhender les arts africains à l’aune des « logiques métisses ».
Il est aujourd’hui essentiel de proposer une relecture des arts africains trop souvent qualifiés de "¿premiers¿" ou " primitifs ", qualificatifs qui sous-tendent l'idée de peuples immuables et d'un art figé dans le temps. Les arts africains portent bien au contraire en eux les traces matérielles et formelles de rencontres et d'échanges multiples, parfois très anciens, aussi bien avec le monde musulman, l'Asie, l'Europe mais également au sein du continent. L’analyse de corpus d’œuvres issus de différents points du continent peut bénéficier du concept de « logiques métisses » développé par l'anthropologue Jean-Loup Amselle. Ces logiques régissaient et régissent encore aujourd’hui les arts africains et viennent interroger les critères de qualification et d’appréciation des œuvres héritées de l’époque coloniale et notamment la question de leur authenticité.
second semestre
Les représentations du pouvoir politique en Afrique.
À partir de la Nubie médiévale, il est possible d’élaborer une histoire des représentations du pouvoir politique en Afrique à travers le temps, dans différents contextes religieux (chrétiens, musulmans, systèmes religieux dits traditionnels) et sociaux. Dans quels contextes une représentation politique plastique existe-elle et quels sont les liens entre les objets et les entités que ces contextes figurent ou manifestent ? Quel est le rapport entre mise en scène du pouvoir et récits, écrits ou oraux, religieux, politiques ou historiques, qui se déploient en parallèle ? Ces questions en sous-tendent d’autres, plus larges et appartenant à l’histoire de l’art, celle du portrait et celle de la représentation, à partir de cas africains. Elles interrogent aussi les manières dont l’histoire des États concernés s’est écrite.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 10h45Emilie Salaberry-Duhoux,Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême.Vendredi 31 octobre 2025, 10h45Emilie Salaberry-Duhoux,Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême.NovembreVendredi 14 novembre 2025, 10h45Emilie Salaberry-Duhoux,Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême.Vendredi 28 novembre 2025, 10h45Emilie Salaberry-Duhoux,Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême.DécembreVendredi 12 décembre 2025, 10h45Emilie Salaberry-Duhoux,Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 10h45Claire Bosc-Tiessé,directrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains.Vendredi 23 janvier 2026, 10h45Claire Bosc-Tiessé,directrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains.FévrierVendredi 6 février 2026, 10h45Claire Bosc-Tiessé,directrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains.Vendredi 20 février 2026, 10h45Claire Bosc-Tiessé,directrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains.MarsVendredi 6 mars 2026, 10h45Claire Bosc-Tiessé,directrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains.- Claire Bosc-Tiessédirectrice de recherche CNRS - directrice d'études à l'EHESS, Institut des Mondes Africains
- Emilie Salaberry-DuhouxDirectrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême), Musée d'Angoulême
 Histoire des arts d'Afrique▶ Inscriptions Closes
Histoire des arts d'Afrique▶ Inscriptions Closes Arts d'Océanie (n°17)Les collections océaniennes issues des voyages d’exploration des années 1830 et 1840.
Arts d'Océanie (n°17)Les collections océaniennes issues des voyages d’exploration des années 1830 et 1840.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 15h45 - 17h45).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Dürer, École du Louvre, Paris : Salle AngkorÉcole du Louvre, Paris : Salle ImhotepÉcole du Louvre, Paris : Salle Nara.
- Début du cours : vendredi 31 octobre 2025.
Alors que la colonisation du Pacifique par les États européens se fait plus franche, les voyages à visée scientifique, commerciale ou militaire se multiplient en Océanie. Les explorateurs y côtoient désormais, outre les marchands, baleiniers et missionnaires occidentaux, celles et ceux qui par choix ou par contrainte (colonies pénitentiaires) aspirent à s’installer dans la région. Les collections réunies dans les années 1830 et 1840 témoignent des changements qui s’opèrent alors dans le Pacifique, mais aussi en Europe et aux États-Unis où certaines disciplines scientifiques (phrénologie) et de d’importantes institutions muséales voient le jour. Nourries d’influences contraires, les cultures matérielles insulaires se renouvellent, elles, à vive allure. Elles incorporent de nouveaux matériaux et embrassent de nouveaux thèmes, font échos aux transformations sociales, politiques et culturelles en cours, mais ne cessent pas pour autant de refléter les identités propres à chaque archipel, à chaque île voire à certaines communautés. Les vastes collections assemblées lors des voyages placés sous le commandement de Jules S. C. Dumont d’Urville (France, 1837-1840) et de Charles Wilkes (États-Unis, 1838-1842) éclairent cette période charnière de l’histoire des arts d’Océanie.
OctobreVendredi 31 octobre 2025, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.NovembreVendredi 28 novembre 2025, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.DécembreVendredi 12 décembre 2025, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.Vendredi 23 janvier 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.FévrierVendredi 6 février 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.Vendredi 20 février 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.MarsVendredi 13 mars 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.Vendredi 20 mars 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.AvrilVendredi 10 avril 2026, 15h45Stéphanie Leclerc Caffarel,Responsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.- Stéphanie Leclerc CaffarelResponsable de collection, département du patrimoine et des collections, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
 Arts d'Océanie▶ Inscriptions Closes
Arts d'Océanie▶ Inscriptions Closes Arts et archéologie des Amériques (n°18)Symbolisme et iconographie dans l’art précolombien du Pérou ancien.
Arts et archéologie des Amériques (n°18)Symbolisme et iconographie dans l’art précolombien du Pérou ancien.- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 15h45 - 17h45).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange, École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : jeudi 23 octobre 2025.
Dans les sociétés complexes de l’Amérique du Sud précolombienne, une riche iconographie se retrouve inscrite, sculptée, gravée ou peinte sur différents supports, dont la céramique, le textile, le bois, la pierre, le métal et même la peau. Ces images et ces symboles couvrent les murs des temples et des palais, le corps, les habits et les objets des individus de haut-rang ainsi que les offrandes qui les accompagnent dans la tombe. D’après les nombreuses études effectuées dans les cultures Chavin, Nasca, Mochica ou Inca, ces systèmes de représentation auraient servi à exprimer et à disséminer les valeurs spirituelles, les préceptes idéologiques et les intérêts – souvent politiques – de la classe dirigeante de ces sociétés. Prendre ces systèmes de représentation à l’œuvre dans le Pérou ancien comme sujet d’étude permet d’envisager plusieurs questions, comme celle de la construction des rapports entre le « monde naturel » et le monde culturel, les notions de « géographie sacrée » et d’écologie rituelle, les systèmes de légitimisation de l’ordre culturel et du pouvoir, enfin quelques éléments structurants des systèmes idéologiques, tel la violence ritualisée, le divin et l’ancienneté.
OctobreJeudi 23 octobre 2025, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.NovembreJeudi 6 novembre 2025, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.Jeudi 20 novembre 2025, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.DécembreJeudi 4 décembre 2025, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.Jeudi 18 décembre 2025, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.JanvierJeudi 15 janvier 2026, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.Jeudi 29 janvier 2026, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.FévrierJeudi 5 février 2026, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.MarsJeudi 12 mars 2026, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.Jeudi 26 mars 2026, 15h45Art et archéologie des AmériquesSteve Bourget,archéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac.- Steve Bourgetarchéologue, responsable de collection Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac
 Arts et archéologie des Amériques▶ Inscriptions Closes
Arts et archéologie des Amériques▶ Inscriptions Closes Histoire de l'architecture occidentale (n°19)Paris 1830-1914. La fabrique d’une capitale.
Histoire de l'architecture occidentale (n°19)Paris 1830-1914. La fabrique d’une capitale.- Jour et horaire : lundi (10 séances : 14h00 - 16h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.
L’évolution de Paris au long du XIXe siècle s’inscrit dans le mouvement d’émulation et de compétition qui saisit alors les capitales européennes, dans un contexte amenant les dirigeants à affirmer de manière visuelle les identités nationales dans les architectures urbaines, pour forger l’adhésion populaire dans ce siècle traversé par les révolutions. Sous le Second Empire, Napoléon III veut faire de Paris la capitale prestigieuse d’un État puissant, à l’égal de Londres. Le cœur de la ville ancienne est complètement transformé par de nombreuses percées facilitant la circulation. L’hygiène urbaine, qui sous-tend aussi ces transformations, sert la propagande impériale. Elle conduit à un renouvellement de l’architecture tout en fabriquant une nouvelle mémoire urbaine qui utilise le substrat monumental. Ces travaux sont poursuivis sous la Troisième République, qui achève de faire de Paris le cœur de l’économie nationale. La monumentalisation des édifices publics est progressivement concurrencée par les bâtiments dus à la commande privée (lieux de spectacle, grands magasins), dans le contexte d’une libéralisation accrue. En réaction contre l’esthétique haussmannienne, la surenchère formelle qui en résulte participe à la spectacularisation de la ville tout entière. Architectes et artistes œuvrent à la construction de cette métropole moderne et de son image.
OctobreLundi 13 octobre 2025, 14h00Fabienne Chevallier,historienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay.Lundi 27 octobre 2025, 14h00Fabienne Chevallier,historienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay.NovembreLundi 24 novembre 2025, 14h00Fabienne Chevallier,historienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay.DécembreLundi 8 décembre 2025, 14h00Fabienne Chevallier,historienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay.JanvierLundi 5 janvier 2026, 14h00Clémence Raynaud,Conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay.Lundi 19 janvier 2026, 14h00Clémence Raynaud,Conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay.FévrierLundi 2 février 2026, 14h00Clémence Raynaud,Conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay.Lundi 16 février 2026, 14h00Clémence Raynaud,Conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay.MarsLundi 2 mars 2026, 14h00Fabienne Chevallier,historienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay.Lundi 16 mars 2026, 14h00Clémence Raynaud,Conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay.- Fabienne Chevallierhistorienne de l'architecture (HDR), chargée de la mission Inventaires et de l'histoire institutionnelle des collections, musée d'Orsay
- Clémence RaynaudConservatrice en chef du patrimoine, Direction de la conservation et des collections, musée d'Orsay
 Histoire de l'architecture occidentale▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'architecture occidentale▶ Inscriptions Closes Histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes (n°20)Nicola Pisano e compagni. Entre retour à l’antique et influences gothiques.
Histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes (n°20)Nicola Pisano e compagni. Entre retour à l’antique et influences gothiques.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 10h45 - 12h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
L’Apulie de Frédéric II, où se déroulent les années de formation de Nicola Pisano, est un creuset où se mêlent – outre les influences byzantines et islamiques – le vif souvenir de l’art de l’Antiquité et les apports stylistiques transalpins les plus contemporains. Les sculptures qu’il crée en Italie centrale dans la deuxième moitié du XIIIe siècle synthétisent les apports de ces deux humanismes, classique et gothique, pour donner naissance à un langage formel nouveau, mêlant souci du volume et attention naturaliste aux détails, rythme des compositions et caractérisation expressive des personnages. Dans l’atelier de Nicola Pisano se forment son fils Giovanni et Arnolfo di Cambio, qui chacun à leur manière assimilent sa leçon et proposent leur propre lecture de sa synthèse entre classicisme renouvelé et innovations gothiques. Giovanni Pisano, particulièrement influencé par ces dernières, sculpte des œuvres marquées par une tension et une émotion exacerbées. Tous trois sont architectes autant que sculpteurs, et ils conçoivent leurs œuvres comme des ensembles cohérents, de Pise à Sienne, de Bologne à Pérouse, de Rome à Orvieto, de Florence à Pistoia. La géographie de leurs réalisations, tout comme leur nature (chaires, tombeaux, décors d’église, mais aussi fontaines), ou encore l’identité de leurs commanditaires, sont révélateurs des dynamiques politiques, sociales et culturelles qui traversent l’Italie de leur temps. Si les dignitaires de l’Eglise, les ordres religieux et les grands aristocrates continuent à être déterminants dans la commande des œuvres, les communautés urbaines et même de riches laïcs jouent un rôle de plus en plus important. Autre signe des changements à l’œuvre, Nicola Pisano et ses successeurs jouissent dès leur époque d’une reconnaissance et d’une notoriété inédites, qui préfigure la place centrale que l’Italie saura donner à ses artistes.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.Vendredi 31 octobre 2025, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.Vendredi 28 novembre 2025, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.DécembreVendredi 12 décembre 2025, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.JanvierVendredi 16 janvier 2026, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.Vendredi 23 janvier 2026, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.FévrierVendredi 6 février 2026, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.Vendredi 20 février 2026, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.MarsVendredi 6 mars 2026, 10h45Raphaël Bories,conservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM.- Raphaël Boriesconservateur du patrimoine, responsable du pôle religions et croyances, MuCEM
 Histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes▶ Inscriptions Closes
Histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes▶ Inscriptions Closes Architecture, décor et ameublement des grandes demeures (n°21)De l’estude au cabinet, la pièce de travail dans la France de la Renaissance, de la fin du XVe au début du XVIIe siècle.
Architecture, décor et ameublement des grandes demeures (n°21)De l’estude au cabinet, la pièce de travail dans la France de la Renaissance, de la fin du XVe au début du XVIIe siècle.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 11h00 - 13h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : vendredi 24 octobre 2025.
Le studium ou studiolo apparaît au Moyen Age et se développe en Italie aux XVe et XVIe siècles. Bien présent en France, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, il évolue, en fonction des règnes successifs, des usages, de l’ameublement et du décor de cette pièce associée à la chambre dans l’habitat aristocratique, au château comme à la ville. En sus des modèles élaborés que représentent les exemples royaux et princiers, les pratiques des milieux lettrés et marchands s’y révèlent, ainsi que les usages masculins et féminins. Au premier tiers du XVIIe siècle, orée du Grand Siècle, se repèrent à la fois les traces d'une continuité et une forte évolution des usages comme des décors.
OctobreVendredi 24 octobre 2025, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.Vendredi 21 novembre 2025, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.Vendredi 19 décembre 2025, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.JanvierVendredi 16 janvier 2026, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.Vendredi 30 janvier 2026, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.FévrierVendredi 13 février 2026, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.MarsVendredi 13 mars 2026, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.Vendredi 27 mars 2026, 11h00Thierry Crépin-Leblond,conservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen.- Thierry Crépin-Leblondconservateur général du patrimoine, directeur, musée national de la Renaissance, château d’Écouen
 Architecture, décor et ameublement des grandes demeures▶ Inscriptions Closes
Architecture, décor et ameublement des grandes demeures▶ Inscriptions Closes Histoire des arts décoratifs (n°22)Les arts décoratifs français aux expositions universelles : l’éclectisme en question (1851-1878).
Histoire des arts décoratifs (n°22)Les arts décoratifs français aux expositions universelles : l’éclectisme en question (1851-1878).- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 14h30 - 16h30).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Au XIXe siècle, les arts décoratifs, que l’on appelle alors « arts industriels », sont touchés par les évolutions sans précédent des modes de production et de consommation entrainés par la révolution industrielle. Leur place dans une société en pleine mutation, le rôle des artistes, le choix de modèles souvent issus du passé ou d’autres cultures, l’innovation technique font l’objet de débats passionnés de la part des élites culturelles, des artistes et des fabricants eux-mêmes. Ces derniers s’organisent face à la concurrence grandissante des autres pays industrialisés, exacerbée par les expositions universelles qui se succèdent d’abord à Londres (1851, 1862) et à Paris (1855, 1867, 1878) puis dans d’autres pays d’Europe (Vienne, 1873) et aux Etats-Unis (Philadelphie, 1876). L’étude des premières expositions universelles, des œuvres qui y furent présentées par les principaux fabricants français et des sources contemporaines, révèle la pluralité des enjeux de cette période, caractérisée par l’éclectisme ayant donné lieu à des créations profondément originales.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.NovembreVendredi 14 novembre 2025, 14h30CO Histoire des arts décoratifsAnaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.Vendredi 28 novembre 2025, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.Vendredi 23 janvier 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.FévrierVendredi 6 février 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.Vendredi 20 février 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.MarsVendredi 6 mars 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.Vendredi 20 mars 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.AvrilVendredi 3 avril 2026, 14h30Anaïs Alchus,conservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay.- Anaïs Alchusconservatrice du patrimoine, Musée d'Orsay
 Histoire des arts décoratifs▶ Inscriptions Closes
Histoire des arts décoratifs▶ Inscriptions Closes Histoire de la mode et du vêtement (n°23)Faire la mode au XXe siècle : fabricants, dessinateurs et décorateurs au service de la haute couture.
Histoire de la mode et du vêtement (n°23)Faire la mode au XXe siècle : fabricants, dessinateurs et décorateurs au service de la haute couture.- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 13h45 - 15h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : jeudi 16 octobre 2025.
L’histoire de la mode au XXe siècle a longtemps fait la part belle à la figure du couturier puis du styliste. Mais il est d’autres voies pour s’interroger sur la fabrication des modes. L’étoffe, matière première par excellence, joue le plus souvent un rôle déterminant dans la conception et la confection des vêtements. En s’intéressant aux fabricants, aux dessinateurs et aux décorateurs qui sont à l’origine de la création textile, d’autres histoires de la haute couture peuvent être explorées : celles des fournisseurs de Charles Frederick Worth, d’Elsa Schiaparelli ou d’Yves Saint Laurent comme celles des motifs de Raoul Dufy pour Paul Poiret ou d’André Brossin de Méré pour les maisons Dior, Balenciaga ou Givenchy. Des contextes de créations variés qui, de l’invention de la haute couture aux podiums des défilés, permettent à la fois d’envisager la mode dans sa matérialité comme de redéfinir le statut des différents acteurs qui y contribuent avec talent.
OctobreJeudi 16 octobre 2025, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.Jeudi 30 octobre 2025, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.NovembreJeudi 13 novembre 2025, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.Jeudi 27 novembre 2025, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.DécembreJeudi 11 décembre 2025, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.JanvierJeudi 22 janvier 2026, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.FévrierJeudi 5 février 2026, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.Jeudi 19 février 2026, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.MarsJeudi 12 mars 2026, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.Jeudi 26 mars 2026, 13h45Histoire de la mode et du vêtementMarion Falaise,responsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.- Marion Falaiseresponsable du service scientifique et des collections , musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon
 Histoire de la mode et du vêtement▶ Inscriptions Closes
Histoire de la mode et du vêtement▶ Inscriptions Closes Histoire de la peinture (école française) (n°24)La peinture à Paris au temps de Simon Vouet.
Histoire de la peinture (école française) (n°24)La peinture à Paris au temps de Simon Vouet.- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 16h00 - 18h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Quels sont les ateliers et peintres qui, sous le règne d’Henri IV, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, constituent la génération qui précède celle de Vouet ? Comment la scène parisienne évolue-t-elle entre 1610 et 1626, en l’absence de ce dernier ? Comment apprécier l’aura de Georges Lallemant et de Claude Vignon, au moment du retour à Paris de Simon Vouet ? Jacques Blanchard constitue-t-il une alternative face à ce dernier ? Autant de questions qui précèdent l’exploration de la formation, du développement et de la postérité d’une « manière de peindre » devenue emblématique du règne de Louis XIII, celle de Simon Vouet qui, rentré d’Italie en 1627 après un long séjour couronné de gloire, s’impose très rapidement sur la scène parisienne qu’il domine tant par la quantité de ses commandes que par l’importance de son atelier. Cette étude soulève plus largement des questions méthodologiques posées par l’étude complexe d’un atelier d’artiste et de son fonctionnement avant la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.NovembreVendredi 7 novembre 2025, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.Vendredi 21 novembre 2025, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.Vendredi 12 décembre 2025, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.Vendredi 30 janvier 2026, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.FévrierVendredi 13 février 2026, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.MarsVendredi 6 mars 2026, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.Vendredi 20 mars 2026, 16h00Guillaume Kazerouni,Responsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes.- Guillaume KazerouniResponsable des collections anciennes (peintures et dessins), Musée des Beaux-Arts de Rennes
 Histoire de la peinture (école française)▶ Inscriptions Closes
Histoire de la peinture (école française)▶ Inscriptions Closes Histoire de la peinture (écoles étrangères) (n°25)Zurbarán, ou l’irruption du surnaturel dans le quotidien.
Histoire de la peinture (écoles étrangères) (n°25)Zurbarán, ou l’irruption du surnaturel dans le quotidien.- Jour et horaire : mercredi (10 séances : 14h45 - 16h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : mercredi 22 octobre 2025.
Moins connu en France que ses contemporains et rivaux, Diego Velázquez et Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Zurbarán (1598-1664) compte parmi les peintres espagnols les plus importants de la peinture européenne du XVIIe siècle. Redécouvert en France par la génération romantique, il a d’abord été considéré comme un caravagesque marqué par l’ascétisme monastique, travaillant la lumière de manière particulièrement expressive. Il a progressivement été reconnu au XXe siècle comme un coloriste prodigieux et célébré pour son style très personnel, qui allie la simplification des volumes à un naturalisme saisissant. Si l’on excepte deux voyages à Madrid, la longue carrière de ce peintre, qui ne semble jamais avoir quitté l’Espagne, s’est principalement développée en Andalousie, à Séville notamment, au service des ordres monastiques. Aux grands cycles religieux, qui ont établi sa renommée, s’ajoutent les peintures de figures isolées, notamment les saintes, magnifiquement vêtues, au charme obsédant. Outre la peinture de dévotion, d’autres volets de l’ample production artistique de Zurbarán méritent d’être mis en exergue, comme les portraits ou encore les natures mortes réalisées en collaboration avec son fils Juan. La singularité de son style est non seulement en rapport avec le contexte artistique et religieux de l’Espagne du Siècle d’or, mais se révèle aussi par l’histoire de la réception de son œuvre, de Théophile Gautier à Balenciaga, en passant par les avant-gardes.
OctobreMercredi 22 octobre 2025, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.NovembreMercredi 5 novembre 2025, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.Mercredi 19 novembre 2025, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.Mercredi 17 décembre 2025, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.JanvierMercredi 28 janvier 2026, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.MarsMercredi 11 mars 2026, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.Mercredi 25 mars 2026, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.Mercredi 1 avril 2026, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.AvrilMercredi 8 avril 2026, 14h45Charlotte Chastel-Rousseau,conservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris.- Charlotte Chastel-Rousseauconservatrice du patrimoine, chargée de la peinture hispanique, de la collection de cadres et de la collection Beistegui, Musée du Louvre, Paris
 Histoire de la peinture (écoles étrangères)▶ Inscriptions Closes
Histoire de la peinture (écoles étrangères)▶ Inscriptions Closes Histoire du dessin (n°26)Une histoire européenne du dessin français. Paris carrefour des arts et des dessins au XVIIe siècle.
Histoire du dessin (n°26)Une histoire européenne du dessin français. Paris carrefour des arts et des dessins au XVIIe siècle.- Jour et horaire : vendredi (9 séances : 11h00 - 13h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Le dessin français du XVIIe siècle a longtemps été étudié comme un domaine clos, une suite de monographies d’artistes, unis par une terre de naissance commune, et du style graphique desquels se dégagerait un certain esprit, particulier à ce pays. Un enjeu, bien différent consiste à considérer la position de la France et de Paris en Europe, à la jonction des chemins entre le Nord et le Sud, entre les Flandres et l’Italie ; de poser la question des transferts culturels : mouvement des artistes, des œuvres et des idées, afin d’identifier leurs impacts sur la création dessinée en France et plus particulièrement à Paris, entre le début et la fin du XVIIe siècle. On peut ainsi déployer à loisir une curiosité pluridisciplinaire, en allant à la rencontre de dessinateurs de tous horizons : d’Italie, de France et des Flandres ; et de toutes orientations : peintres, sculpteurs, architectes, ornemanistes, scénographes de théâtre, etc. Se dégagent ainsi, à travers le dessin, les conséquences de séjours brefs ou durables d’artistes étrangers en France (Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d’Arpin, Orazio Gentileschi, Stefano della Bella, Giovanni Francesco Romanelli, Gian Lorenzo Bernini et ses assistants mais encore Philippe de Champaigne ou Rubens) ; de même que l’impact des voyages et présences d’artistes français ailleurs en Europe, en Italie d’abord (Simon Vouet, Nicolas Poussin, Jacques Stella, Charles Le Brun, les Pensionnaires de l’Académie de France à Rome, etc.), en Angleterre aussi (particulièrement après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685). Au-delà du voyage des hommes, il convient d'interroger les conséquences, sur l’art du dessin, du voyage des œuvres (la constitution à Paris au XVIIe siècle de certaines des plus belles collections de dessins étrangers jamais réunies, de même que la présentation d’œuvres étrangères aussi admirées que les toiles du cycle de Marie de Médicis peintes par Rubens, etc.). Voyage enfin des théories de l’art, des idées : ainsi se constitue une histoire européenne du dessin français.
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.NovembreVendredi 14 novembre 2025, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.Vendredi 28 novembre 2025, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.Vendredi 23 janvier 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.FévrierVendredi 6 février 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.Vendredi 20 février 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.MarsVendredi 6 mars 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.AvrilVendredi 3 avril 2026, 11h00Victor Hundsbuckler,conservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre.- Victor Hundsbucklerconservateur du patrimoine, département des arts graphiques, musée du Louvre
 Histoire du dessin▶ Inscriptions Closes
Histoire du dessin▶ Inscriptions Closes Histoire de l'estampe (n°27)Cartes à jouer & tarots, le monde en miniature.
Histoire de l'estampe (n°27)Cartes à jouer & tarots, le monde en miniature.- Jour et horaire : lundi (10 séances : 17h45 - 19h45).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne, École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.
- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.
Arrivées d’Orient en Occident au XIVe siècle, les cartes à jouer figurent parmi les premiers exemples de gravure en Europe. Rapidement protéiformes, elles embrassent les modes et les préoccupations de leurs époques et des sociétés dans lesquelles elles sont produites, et demeurent aujourd’hui des objets culturels ludiques d’une incroyable plasticité. Après avoirr esquissé une brève histoire de la carte à jouer dans le monde, il s’agit d’examiner les premiers jeux et les tarots princiers du XVe siècle, richement décorés et enluminés, pour porter ensuite le regard sur les cartes faites pour le jeu, puis les cartes faites pour instruire ; d’ouvrir une fenêtre sur la cartomancie et les cartes et tarots à fonction divinatoire, du XVIIIe siècle à nos jours ; de voir dans quelle mesure les cartes sont porteuses d’un message politique et accompagnent les changements de régime ; d’interroger au XIXe siècle la mise en place des brevets et l’arrivée de la lithographie, en regard de la constitution de monopoles chez les plus grands fabricants ; d’étudier l’invention du joker, carte aux racines européennes qui se diffuse dans la culture populaire, la bande dessinée et le cinéma ; d’admirer enfin les jeux artistiques et les jeux d’artistes. Le Département des Estampes et de la photographie de la BnF, permet de découvrir une partie des quelques 3000 jeux de cartes qui y sont conservés et en font l’une des plus belles réunions de cartes à jouer au monde.
OctobreLundi 13 octobre 2025, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .Lundi 27 octobre 2025, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .NovembreLundi 17 novembre 2025, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .Lundi 24 novembre 2025, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .DécembreLundi 8 décembre 2025, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .JanvierLundi 12 janvier 2026, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .Lundi 19 janvier 2026, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .FévrierLundi 2 février 2026, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .Lundi 16 février 2026, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .MarsLundi 2 mars 2026, 17h45Jude Talbot,responsable des prêts aux expositions à la BNF .- Jude Talbotresponsable des prêts aux expositions à la BNF
 Histoire de l'estampe▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'estampe▶ Inscriptions Closes Histoire de l'art au XIXe et au début du XXe siècle (n°28)Manet
Histoire de l'art au XIXe et au début du XXe siècle (n°28)Manet
Edouard Manet, ou la vie à l’œuvre.- Jour et horaire : mercredi (10 séances : 14h45 - 16h45).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.
Plus notre connaissance de l’art et de la vie de Manet (1832-1883) progresse, plus s’impose la nécessité de les comprendre ensemble, hors de l’illusion biographique qui consister à réduire l’image à la traduction littérale de ce que l’on croit savoir de son auteur. Manet lui-même ne nous met-il pas en garde contre une telle naïveté méthodologique ? Le réalisme, tel qu’il le conçoit, ne fait-il pas ouvertement sa place à la part de fiction dont l’exercice de la peinture lui semble inséparable ? Du reste, la citation répétée, et presque compulsive, des anciens maîtres confirme moins les carences de son imagination que l’ambition de hisser la représentation du monde moderne à une hauteur identique de sens et d’émotion. Les vingt-cinq dernières années ont vu se multiplier les livres et les expositions visant à cerner la composante autobiographique de son corpus, des tableaux aux livres illustrés. Au-delà du bilan qu’appelle ce quart de siècle, on peut encore élargir le propos, sans se contenter de repérer la présence de tel ou tel membre de sa famille, ou de sa belle-famille, dans ses œuvres, vouées ou non à l’espace public. Car Manet peint moins sa vie qu’il ne la romance ou n'en transpose les tensions constitutives. De plus, il est devenu évident que son existence doit se comprendre à l’intérieur de déterminations sociales, politiques et commerciales précises. En somme, éclairer l’œuvre de Manet à partir de sa vie, ou comprendre son carriérisme pugnace, exige de repenser les limites de tout destin individuel.
OctobreMercredi 15 octobre 2025, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.NovembreMercredi 12 novembre 2025, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.Mercredi 26 novembre 2025, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.JanvierMercredi 7 janvier 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.Mercredi 21 janvier 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.FévrierMercredi 4 février 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.Mercredi 18 février 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.MarsMercredi 4 mars 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.Mercredi 18 mars 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.JuinMercredi 3 juin 2026, 14h45Stéphane Guégan,conservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay.- Stéphane Guéganconservateur du patrimoine, conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay, musée d'Orsay
 Histoire de l'art au XIXe et au début du XXe siècle▶ Inscriptions Closes
Histoire de l'art au XIXe et au début du XXe siècle▶ Inscriptions Closes Art du XXe siècle (n°29)D'autres "modernités". L'Art déco et ses déclinaisons, des années 1910 aux années 1930.
Art du XXe siècle (n°29)D'autres "modernités". L'Art déco et ses déclinaisons, des années 1910 aux années 1930.- Jours et horaires : mercredi (6 séances : 17h15 - 19h15, 3 séances : 17h15 - 19h30, 1 séance : 18h15 - 19h15).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.
En 2025, plusieurs expositions ou manifestations scientifiques organisées à l’occasion du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes (Paris, 1925), permettent de revenir sur les contours du mouvement dit « Art déco ». Alors que cette appellation même n’apparaît que rétrospectivement, dans les années 1960, aussi désigne-t-elle une production qui, des années 1910 aux années 1930, voire au-delà, se serait située en marge des avant-gardes historiques, tout du moins selon une historiographie largement remise en cause aujourd’hui. S’exprimant particulièrement dans les champs de l’architecture et des arts décoratifs, mais touchant aussi bien à la peinture, à la sculpture ou aux arts graphiques, ces autres « modernités » n’en demeurent pas moins difficiles à définir de manière univoque. Leurs sources d’inspiration s’avèrent en effet très hétérogènes, qu’il s’agisse des styles néo-classiques, de l’africanisme, des arts extrême-orientaux, des arts précolombiens, du régionalisme ou encore de l’essor des sports et des transports… De Paul Iribe et Jacques-Émile Ruhlmann à Francis Jourdain et Robert-Mallet Stevens, on repère l’opposition fréquemment pointée entre, d’une part, un versant dit traditionaliste de l’Art déco, et d’autre le modernisme fonctionnaliste, du Bauhaus, du Corbusier et de l’UAM, « catégories » dont il s’agira surtout d’envisager les porosités.
OctobreMercredi 15 octobre 2025, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.Mercredi 29 octobre 2025, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.NovembreMercredi 12 novembre 2025, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.Mercredi 26 novembre 2025, 18h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.DécembreMercredi 10 décembre 2025, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.JanvierMercredi 7 janvier 2026, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.Mercredi 21 janvier 2026, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.FévrierMercredi 4 février 2026, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.Mercredi 18 février 2026, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.MarsMercredi 4 mars 2026, 17h15Jérèmie Cerman,professeur d’histoire de l’art contemporain.- Jérèmie Cermanprofesseur d’histoire de l’art contemporain
 Art du XXe siècle▶ Inscriptions Closes
Art du XXe siècle▶ Inscriptions Closes Art contemporain (n°30)Sous l’angle de la fiction. Modalités de la narration dans l’art contemporain.
Art contemporain (n°30)Sous l’angle de la fiction. Modalités de la narration dans l’art contemporain.- Jour et horaire : jeudi (20 séances : 12h15 - 13h15).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.
- Début du cours : jeudi 16 octobre 2025.
En ouverture de son ouvrage Les Bords de la fiction (2017), Jacques Rancière convoque la thèse formulée par Aristote (Poétique) selon laquelle « ce qui distingue la fiction de l’expérience ordinaire, ce n’est pas un défaut de réalité mais un surcroît de rationalité ». Frontières et points de contact entre expérience et fiction, tels qu’ils ont été posés, mis au jour, déplacés, tordus même par les artistes depuis les années 1960, peuvent être mis en lien avec les redéfinitions de la pratique et de ses productions (assemblages, environnements et happenings : pour reprendre le titre d’un ouvrage publié par Allan Kaprow en 1956), ainsi qu’à la faveur des évolutions du champ technologique (de l’art vidéo aux images numériques, de Nam June Paik à Hito Steyerl). Certaines œuvres sont ancrées dans une veine documentaire, se déployant sur le mode de l’enquête, alors que d’autres font appel à l’imaginaire, à l’étrangeté, au mystère. L’art corporel présente à cet égard autant d’intérêt que les images et les espaces virtuels, les effets de réels (étudiés par Roland Barthes) autant que les simulacres (théorisé par Jean Baudrillard), la théorie autant qu’aux actions. Entre l’hyperréalisme et le simulationnisme, entre le travail de la main et la création en réseaux, existent des zones de tension, une gamme des choix et de positions qu’elles induisent chez les artistes contemporains.
OctobreJeudi 16 octobre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 23 octobre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 30 octobre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.NovembreJeudi 6 novembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 13 novembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 27 novembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.DécembreJeudi 4 décembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 11 décembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 18 décembre 2025, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.JanvierJeudi 8 janvier 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 15 janvier 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 22 janvier 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 29 janvier 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.FévrierJeudi 5 février 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 12 février 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 19 février 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.MarsJeudi 12 mars 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 19 mars 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.Jeudi 26 mars 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.AvrilJeudi 9 avril 2026, 12h15Guitemie Maldonado,docteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris.- Guitemie Maldonadodocteure en histoire de l'art contemporain, professeure d'histoire générale de l'art XXe-XXIe siècles, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris
 Art contemporain▶ Inscriptions Closes
Art contemporain▶ Inscriptions Closes Histoire de la photographie (n°31)La photographie sur le continent africain : un outil d’émancipation artistique et politique du regard (1950–2000).
Histoire de la photographie (n°31)La photographie sur le continent africain : un outil d’émancipation artistique et politique du regard (1950–2000).- Jour et horaire : lundi (10 séances : 14h00 - 16h00).
- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Dürer, École du Louvre, Paris : Salle Imhotep.
- Début du cours : lundi 20 octobre 2025.
Quelles furent les pratiques et les usages de la photographie sur le continent africain, depuis les premiers mouvements d’Indépendance jusqu’à la période actuelle, caractérisée par une reconnaissance institutionnelle et artistique de certaines figures de l’histoire de la photographie ? On peut répondre à ces questions à travers la présentation de trajectoires singulières, par exemple celles de James Barnor, J.D Okhai Ojeikere, Malik Sidibé, Sanry Solé, David Goldblatt, Samuel Fosso, ou encore Felicia Abban et Zanele Muholi, femmes pionnières de la photographie africaine dans les années 1950-1970. L’étude d’ouvrages emblématiques (par exemple Willis Bell et Efua Sutherland, The Roadmakers, 1961 ; Ernest Cole, House of Bondage, 1967…) d’expositions ou d’événements culturels (festival Festac, Lagos, Nigéria, 1977 ; exposition African photographers, 1940 to the present, Solomon R. Guggenheim Museum, 1996…) offrent aussi l’occasion d’aborder les enjeux tant historiographiques que curatoriaux soulevés par la photographie sur le continent africain.
OctobreLundi 20 octobre 2025, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.NovembreLundi 3 novembre 2025, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.Lundi 10 novembre 2025, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.DécembreLundi 8 décembre 2025, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.JanvierLundi 12 janvier 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.Lundi 26 janvier 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.FévrierLundi 9 février 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.MarsLundi 2 mars 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.Lundi 16 mars 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.Lundi 30 mars 2026, 14h00Damarice Amao,assistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.- Damarice Amaoassistante de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d'art moderne, Centre Pompidou
 Histoire de la photographie▶ Inscriptions Closes
Histoire de la photographie▶ Inscriptions Closes Histoire du cinéma (n°32)Face aux monstres.
Histoire du cinéma (n°32)Face aux monstres.
Les représentations du monstre à l’écran : de l’esthétique à la dimension sociale et politique- Jour et horaire : vendredi (10 séances : 13h00 - 15h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Michel-Ange.
- Début du cours : vendredi 17 octobre 2025.
Qu’il soit mythologique ou légendaire, de nature humaine ou animale, naturel ou fantastique, le monstre est une figure primale et majeure dans l’histoire de l’art et des représentations. Monstrum désigne d’abord un « prodige qui avertit de la volonté des dieux, qui la montre ». De l’art figuratif, en passant par la littérature et le théâtre, ces êtres trouvent un prolongement naturel au cinéma, art populaire par excellence, dès son apparition. À quelles évolutions et modifications esthétiques ces créatures (êtres à l’anatomie déformée, hybride ou augmentée ; figures fantastiques), dont l’étrangeté est d’abord une forme, ont-elles dû se plier pour pénétrer dans l’univers des images animées ? Le cinéma construit une nouvelle visibilité du monstrueux, mais invente en même temps de nouveaux monstres, de nouvelles mythologies de la monstruosité. Sur les plans psychologique et social, les monstres incarnent des pulsions irréductibles et perturbantes. Ils suscitent surtout l’un des sentiments humains les plus puissants, et l’un des leviers primordiaux de toute société : la peur, peur du futur, de l’au-delà ou de « l’autre », peur ressentie physiquement ou moralement. Ainsi, ces monstres reflètent une certaine image des sociétés qui les ont conçus. Que peuvent-ils nous en dire ?
OctobreVendredi 17 octobre 2025, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.NovembreVendredi 14 novembre 2025, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.Vendredi 28 novembre 2025, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.DécembreVendredi 12 décembre 2025, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.JanvierVendredi 9 janvier 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.Vendredi 23 janvier 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.FévrierVendredi 6 février 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.Vendredi 20 février 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.MarsVendredi 6 mars 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.Vendredi 20 mars 2026, 13h00Paola Palma,docteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie.- Paola Palmadocteure en lettres et philologie, TP histoire du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université Caen Normandie
 Histoire du cinéma▶ Inscriptions Closes
Histoire du cinéma▶ Inscriptions Closes Anthropologie du patrimoine (n°33)Folklore et folklorisme en France et en Europe : pratiques, savoirs, muséographies.
Anthropologie du patrimoine (n°33)Folklore et folklorisme en France et en Europe : pratiques, savoirs, muséographies.- Jours et horaires : lundi (4 séances : 13h30 - 16h00, 5 séances : 14h00 - 16h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Dürer.
- Début du cours : lundi 27 octobre 2025.
Longtemps associé à une culture populaire qui serait figée dans un passé idéalisé, le folklore a connu de profondes évolutions dans ses définitions et ses usages. Né en Angleterre au milieu du XIXe siècle, le terme, formé de « folk » (peuple) et « lore » (légende, histoire, savoirs), désigne littéralement l’ensemble des savoirs du peuple. Depuis le XIXe siècle, les collectes folkloriques – nourries par des intentions régionalistes ou nationalistes et par un objectif de sauvegarde culturelle – ont façonné des représentations durables de la tradition, souvent en décalage avec les pratiques vivantes. Le folklorisme, quant à lui, désigne la mise en scène de ces traditions dans des contextes de performance, de patrimonialisation ou de valorisation touristique. A partir de matériaux ethnographiques et d’exemples historiques, se repèrent les processus de construction, de transformation et de réinvention de ces formes culturelles. On peut ainsi interroger les logiques de sélection, de mise en forme et d’authentification à l’œuvre dans la notion de folklore, à l’aune des relations entre pratiques vernaculaires, politiques culturelles ainsi que des enjeux identitaires. Ainsi peut-on apprécier comment les démarches de sauvegarde du passé interagissent avec les dispositifs contemporains de patrimonialisation, en particulier dans le cadre du patrimoine culturel immatériel.
OctobreLundi 27 octobre 2025, 13h30Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.NovembreLundi 17 novembre 2025, 13h30Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.DécembreLundi 15 décembre 2025, 13h30Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.JanvierLundi 5 janvier 2026, 13h30Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.Lundi 19 janvier 2026, 14h00Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.FévrierLundi 2 février 2026, 14h00Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.Lundi 16 février 2026, 14h00Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.MarsLundi 9 mars 2026, 14h00Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.Lundi 30 mars 2026, 14h00Marie-Charlotte Calafat,conservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille.- Marie-Charlotte Calafatconservatrice du patrimoine, directrice scientifique des collections, MUCEM, Marseille
 Anthropologie du patrimoine▶ Inscriptions Closes
Anthropologie du patrimoine▶ Inscriptions Closes Patrimoine naturel, technique et industriel (n°34)L’expérience scientifique au musée.
Patrimoine naturel, technique et industriel (n°34)L’expérience scientifique au musée.- Jour et horaire : mercredi (10 séances : 14h00 - 16h00).
- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne.
- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.
Louis Pasteur (1822-1895) est universellement connu pour la découverte du vaccin contre la rage qui couronne une carrière d’expérimentateur hors pair. Cette découverte est à l’origine de la création de l’Institut Pasteur en 1887, fondation privée reconnue d’utilité publique qui est à la fois un centre de recherche, un centre d’enseignement et un centre de vaccination. Au sein du musée Pasteur, la salle dite des « souvenirs scientifiques » créée en 1938 présente en onze vitrines l’œuvre de l’illustre savant. Cette salle constitue aussi un témoignage unique de la façon dont on expose les sciences expérimentales à la fin des années trente, c’est-à-dire au moment de l’inauguration du Palais de la découverte, le lieu où l’on montre « la science en train de se faire » selon l’expression de Jean Perrin (1870-1942). Quatre-vingt-dix plus tard, le Palais de la Découverte réouvre ses portes avec de nouvelles propositions de médiation et le musée de l’Institut Pasteur est en cours de transformation. Ces deux études de cas, enrichies d’autres exemples français et européens, permettent de réfléchir aux modalités et aux enjeux de l’expérience scientifique au sein des musées de sciences et des institutions de culture scientifique et technique.
OctobreMercredi 15 octobre 2025, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.Mercredi 22 octobre 2025, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.NovembreMercredi 12 novembre 2025, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.Mercredi 26 novembre 2025, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.JanvierMercredi 21 janvier 2026, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.FévrierMercredi 4 février 2026, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.Mercredi 18 février 2026, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.MarsMercredi 11 mars 2026, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.Mercredi 25 mars 2026, 14h00Laurence Isnard,Responsable du musée Pasteur, Musée Pasteur.- Laurence IsnardResponsable du musée Pasteur, Musée Pasteur
 Patrimoine naturel, technique et industriel▶ Inscriptions Closes
Patrimoine naturel, technique et industriel▶ Inscriptions Closes