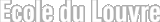lms.ecoledulouvre.fr
Accédez à :
- Vos cours (ressources pédagogiques et bibliographies)
- Extranet (planning des cours, annulation et report, informations pratiques)
CAEN
Les cours sont organisés avec l'Association Amis du musée des Beaux-Arts de Caen et se déroulent au musée des Beaux-Arts de Caen,
Le Château, 14000 Caen.
Contact : [email protected]
consulter les conditions générales d'inscription
Je m'inscris par voie postale
Des places sont disponibles par correspondance, veuillez trouver ci-dessous les documents à télécharger et à envoyer :
 « Leur vie domestique sera intégrée dans un rêve virgilien ». Les villas médicéennes à la Renaissance. Architecture, jardin, décors. (n°1)
« Leur vie domestique sera intégrée dans un rêve virgilien ». Les villas médicéennes à la Renaissance. Architecture, jardin, décors. (n°1)- Jour et horaire : mercredi (5 séances : 17h45 - 19h15).
- Lieu : Musée des Beaux-Arts de Caen : Salle de conférence .
- Début du cours : mercredi 8 octobre 2025.
Les propos de Le Corbusier soulignent bien l’ambition de la villa : élever le quotidien au rang d’idéal. Ce cycle de cours se propose de revenir sur l’exemple le plus prestigieux, les villas médicéennes, inscrites sur les listes des biens culturels et naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2013. Dans leurs résidences suburbaines ou de campagne, les Médicis ont en effet porté au plus haut niveau de sophistication la résurrection de la villa antique, dans un savant mélange de domestication d’une nature parfois sauvage et célébration de la culture humaniste. Cette promenade en Toscane nous conduira sur les traces de cette illustre famille florentine, du père fondateur Cosme l’Ancien jusqu’aux duc et grands-ducs de Toscane, en passant par Laurent le Magnifique. Elle s’intéressera au contexte de résurgence des modèles des Anciens, et de la philosophie qui lui est attaché. L’architecture se fait alors de moins en moins défensive au profit d’un dialogue étroit et poétique avec le paysage environnant. Architecture, jardins et décors se mettent ainsi au diapason afin de faire de la villa un symbole brillant de la Renaissance italienne.
OctobreMercredi 8 octobre 2025, 17h45D’Horace à Boccace. Naissance et résurrection de la villa à la Renaissance.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.Mercredi 15 octobre 2025, 17h45Cosme l’Ancien et les villas-châteaux (Trebbio, Cafaggiolo, Careggi).Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.NovembreMercredi 5 novembre 2025, 17h45L’idéal humaniste de Laurent le Magnifique (Fiesole, Poggio a Caiano).Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.Mercredi 26 novembre 2025, 17h45Le jardin des Hespérides du duc Cosme et François Ier (Castello, Pratolino, Boboli).Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.DécembreMercredi 17 décembre 2025, 17h45De Sandro Botticelli à Pontormo, d’Andrea del Verrocchio à Bronzino. Le décor des villas.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.- Matteo Gianeselliconservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen
 « Leur vie domestique sera intégrée dans un rêve virgilien ». Les villas médicéennes à la Renaissance. Architecture, jardin, décors.▶ Inscriptions Closes
« Leur vie domestique sera intégrée dans un rêve virgilien ». Les villas médicéennes à la Renaissance. Architecture, jardin, décors.▶ Inscriptions Closes Le siècle d'or de la peinture espagnole. (n°2)
Le siècle d'or de la peinture espagnole. (n°2)- Jour et horaire : mercredi (5 séances : 17h45 - 19h15).
- Lieu : Musée des Beaux-Arts de Caen : Salle de conférence .
- Début du cours : mercredi 4 février 2026.
Prisonnière d’une foi catholique austère et exigeante, ruinée par la faillite de son économie, affaiblie par la perte des Flandres, l’Espagne s’abandonne au cours du XVIIe siècle aux songes de sa grandeur passée, confiant aux peintres le soin de ressusciter, à travers leurs œuvres, les mânes d’un empire jadis puissant et révéré. Diego Velasquez (1599-1660), Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), José de Ribera (1591-1662) et Francisco de Zurbaran (1598-1664) deviennent ainsi les chantres d’un royaume idéal, où la famille royale apparait forte et unie, où la religion se teinte des douceurs de la grâce, où la pauvreté devient chef d’œuvre.
FévrierMercredi 4 février 2026, 17h45Du songe à la réalité : Ribera.Aude Prigot,docteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre.Mercredi 11 février 2026, 17h45Zurbaran, portraitiste de la foi.Aude Prigot,docteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre.MarsMercredi 11 mars 2026, 17h45Murillo ou la douceur sévillane.Aude Prigot,docteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre.Mercredi 18 mars 2026, 17h45Velasquez ou l’apprentissage de la liberté.Aude Prigot,docteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre.Mercredi 25 mars 2026, 17h45Les vibrations du baroque : Alonzo Cano et Claudio Coello.Aude Prigot,docteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre.- Aude Prigotdocteure en histoire de l'art, chargée de cours, Ecole du Louvre
 Le siècle d'or de la peinture espagnole.▶ Inscriptions Closes
Le siècle d'or de la peinture espagnole.▶ Inscriptions Closes