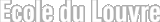lms.ecoledulouvre.fr
Accédez à :
- Vos cours (ressources pédagogiques et bibliographies)
- Extranet (planning des cours, annulation et report, informations pratiques)
QUIMPER
Les cours sont organisés avec le musée des Beaux-Arts de Quimper et se déroulent à l'hôtel Mercure,
21 bis, avenue de la Gare, 29000 Quimper
Contact : [email protected]
consulter les conditions générales d'inscription
Je m'inscris par voie postale
Des places sont disponibles par correspondance, veuillez trouver ci-dessous les documents à télécharger et à envoyer :
 "Le grand atelier d'Italie". L'art à Florence aux XVe et XVIe siècles. (n°1)
"Le grand atelier d'Italie". L'art à Florence aux XVe et XVIe siècles. (n°1)- Jours et horaires : lundi (4 séances : 18h30 - 20h00), mardi (1 séance : 18h30 - 20h00).
- Lieu : Hôtel Mercure Quimper Centre : Amphithéâtre.
- Début du cours : lundi 2 mars 2026.
À la fin du XIVe siècle, l’extraordinaire développement industriel, commercial et bancaire dont bénéficie la Toscane soutient la renaissance des lettres et des arts qui avaient connu un ralentissement abrupt avec la Peste noire (1348). Au tournant du siècle, ce réveil, ou cette « seconde naissance » tant vantée par Giorgio Vasari, s’affirme tout particulièrement à Florence, capitale d’un nouvel âge d’or humaniste.
Il s’agira d’évoquer cette période brillante de l’art occidental, fondée sur la mise au point de la perspective mathématique et nourrie par le culte de l’Antiquité, qui voit s’épanouir, entre XVe et XVIe siècle, l’art des plus grands protagonistes de la Renaissance italienne, de Masaccio à Michel-Ange, en passant par Donatello ou Andrea del Verrocchio.
Nous pénétrerons l’intimité des grandes botteghe florentines en observant notamment le dialogue fécond entre les arts et les techniques, face à une demande variée des commanditaires dans le domaine de la dévotion et du portrait. Pour soutenir l’économie de l’atelier, ces maitres doivent aussi s’affirmer comme d’habiles fournisseurs de modèles pour des artisans verriers, orfèvres, brodeurs…, rendant souvent bien relatifs pour la Renaissance les concepts traditionnels d’autographie et de scission entre arts majeurs et arts mineurs.
MarsLundi 2 mars 2026, 18h30Du gothique international à la première Renaissance. Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Masaccio, Fra'Angelico.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.Lundi 16 mars 2026, 18h30Au service des Médicis. Donatello, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.Lundi 23 mars 2026, 18h30La maturation de la Renaissance. Les Pollaiolo, Andrea del Verrocchio.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.Lundi 30 mars 2026, 18h30L’âge des grands ateliers. Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Le Pérugin, Filippino Lippi.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.AvrilMardi 7 avril 2026, 18h30Le classicisme à Florence. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Fra’ Bartolomeo, Raphaël.Matteo Gianeselli,conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen.- Matteo Gianeselliconservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures, tapisseries, arts graphiques, textiles et cuirs, musée de la Renaissance, Ecouen
 "Le grand atelier d'Italie". L'art à Florence aux XVe et XVIe siècles.
"Le grand atelier d'Italie". L'art à Florence aux XVe et XVIe siècles.